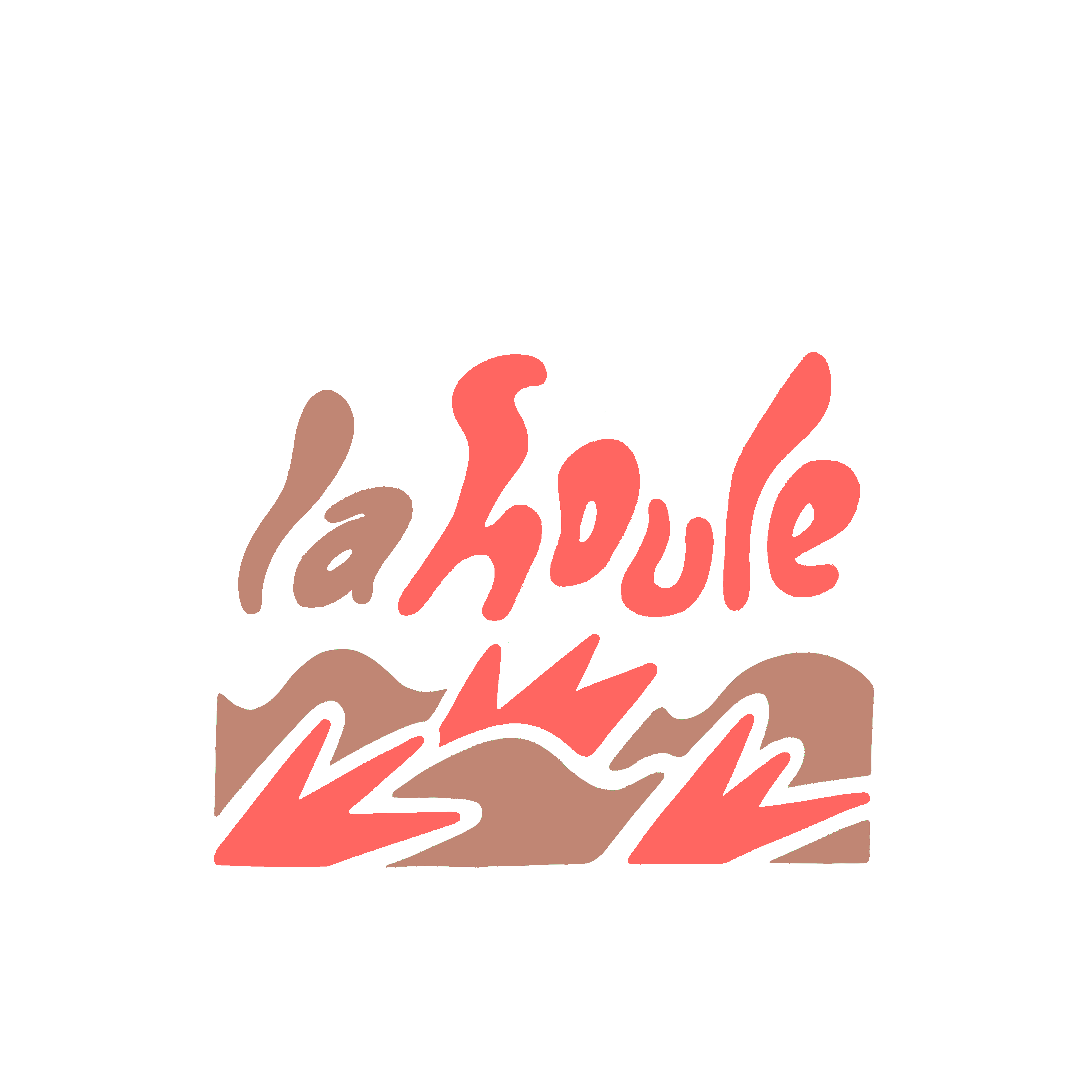Il existe des formations de plusieurs années pour apprendre le documentaire, en podcast ou pour la radio, et autant pour la technique sonore de la prise de son à la réalisation. Ce guide n’ayant aucunement la prétention de remplacer cette somme considérable de connaissances et de pratiques, il est plutôt fait pour les personnes qui ne savent pas par ou commencer.
Sommaire
- Pour qui, pourquoi
- L’écriture d’un projet documentaire
- Quel matériel d’enregistrement ?
- Le montage
- Comment financer mon projet ?
Pour qui, et pourquoi un projet de podcast documentaire ?
Définition
Pour commencer, le podcast documentaire est un champ très large, et dont les définitions sont aujourd’hui multiples, et parfois contradictoires. Cette forme dénote cependant du reportage par sa temporalité, plus longue, que celle d’un format d’actualité. On peut retrouver :
- Le documentaire “classique” : une enquête sur un sujet, dont la construction se rapproche de celle des documentaires pour la télévision et ont un caractère souvent “mag”, avec une voix off impersonnelle et un propos didactique
- Le récit documentaire : il raconte une histoire particulière, et peut être à la première personne ou non. Ce type de documentaire est porté par une voix incarnée qui s’adresse directement aux auditeur·ices
- Le documentaire de création : docu-fiction, pièce sonore documentaire, expérimentation sonore… dans cette catégorie se retrouvent des objets sonores inclassables et pluriels
L’écriture d’un projet documentaire
L’écriture d’un projet de podcast documentaire est une chose qui s’apprend, mais surtout, qui s’expérimente en faisant. Plusieurs étapes sont nécessaires, mais certaines ne dépendent que de vous, et de votre manière d’écrire. Les studios de production de prendront pas de projets déjà tournés. Il leur faut un projet écrit, et il en va de même pour les bourses d’auteur·ices.
Écrire avant de tourner
Même si vous avez déjà des rushes, ne vous lancez pas dans le gros du travail avant d’avoir structuré votre pensée, votre vision et votre propos. Faites un plan, éventuellement une liste d’épisodes, et une première liste d’ambiances sonores ou d’archives, de personnes à interviewer, de textes à lire…
Vous pouvez construire un parti pris au fur et à mesure du tournage, et vous laisser surprendre. Mais imaginer des mise en scène en amont, choisir les personnes qui seront les personnages, les fils rouges de votre travail est essentiel, même si vous vous affranchissez un peu (beaucoup) de ce cadre ensuite.
✒️ Utilisez un document pour structurer votre travail, qui donnera dans un second temps le script de votre projet.
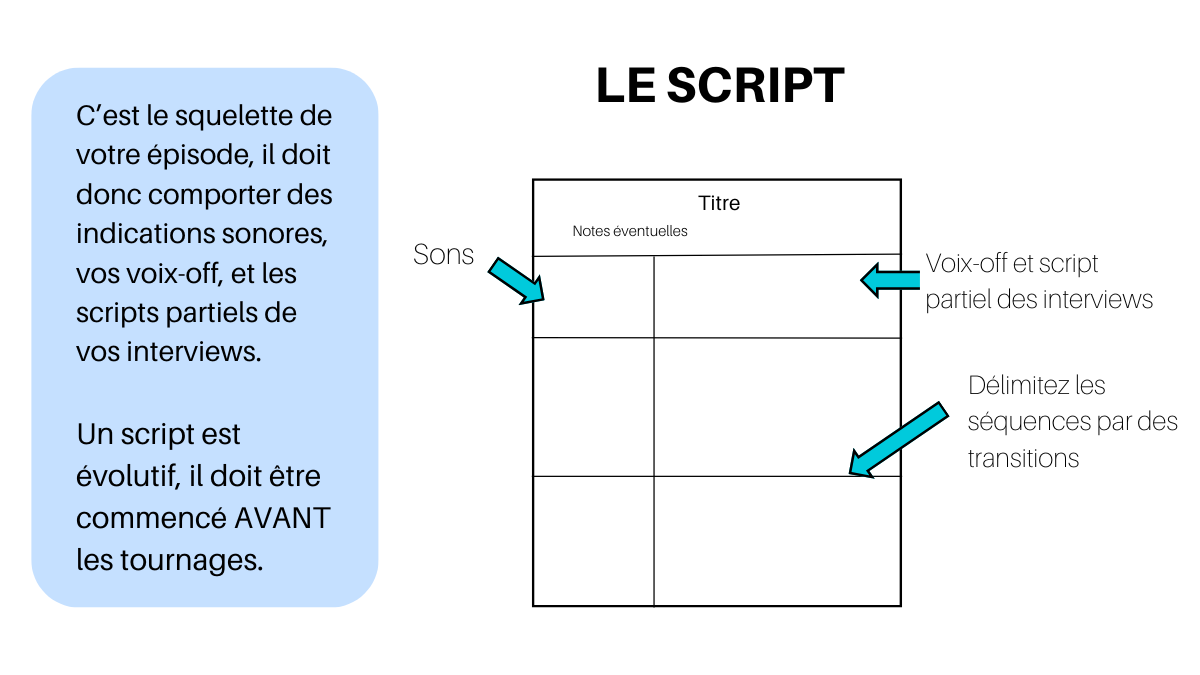
Écouter, voir, regarder
Un documentaire sonore s’écrit avec du son. Dans la mesure du possible, rencontrez les gens, parlez-leur, écoutez les lieux, déplacez-vous, faites des photos, des dessins… bref, faites vivre l’univers dans lequel vous allez vous plonger. Cela nourrira considérablement votre écriture.
🗒️ Pour aller plus loin : Se former à l’écriture sonore
Quel matériel d’enregistrement ?
Quel set-up d’enregistrement ?
Dans un premier temps, considérez vos propres compétences en son. Si vous n’avez jamais touché un enregistreur, ce n’est pas la peine d’investir dans un matériel cher que vous ne saurez pas utiliser. Par exemple, certains micros pour la voix ne s’utilisent qu’avec des amplis particuliers qui sont des machines faites pour rester en studio, et ne vous serviront à rien à l’extérieur. Si vous ne savez pas les choisir, faites simple !
Les enregistreurs
- Chez Zoom : Zoom est une marque de Sony, qui produit plusieurs enregistreurs tout terrain. L’entrée de gamme, le Zoom H1, ne sera pas suffisant pour des prises de son voix de qualité. Il faut au moins choisir un modèle H4n, où H5, voir supérieur. Un peu chers à l’achat (250€ environ), ils sont dotés d’un pré-ampli efficace qui vous permettra à la fois des prise de son avec les micros intégrés, mais aussi de brancher des micros pour la voix sur leurs entrées XLR. Le Zoom H6 coûte sensiblement plus cher, et à part des entrées supplémentaires, ne vous apportera pas forcément un gain de qualité sonore…
- Chez Tascam : Tascam l’américain propose un modèle robuste (s’il résiste aux manifestations des Gilets Jaunes à Paris, il résiste à beaucoup de choses !) : le DR40. Efficace avec ses micro interne, il l’est beaucoup moins avec des micro mains branchés en XLR (le pré-ampli n’étant pas suffisant, il produit un souffle trop conséquent pour un enregistrement de qualité). Si vous voulez un modèle facile à utiliser, dehors comme dedans, vous pouvez choisir son dernier né, le DR-05Xpro, tout petit et très efficace avec ses micros internes. Pour faire de la prise de son avec des micros voix branchés en XLR, il faudra passer sur les modèles beaucoup plus chers type Portacapture (plutôt autour de 300) mais dont les retours sont plutôt bons.
- Chez Marantz, Nagra, et les autres pro : vous trouverez des modèles chez ces constructeurs, chers, avec des pré-amplis qualitatifs. Mais honnêtement, nous n’avons pas trouvé que le gain en qualité de son était meilleur qu’avec un bon boitier des marques citées plus haut et un micro adapté. Notre seul conseil : testez-les, et évaluez votre besoin en nombre de pistes avant de dépenser une somme conséquente.
Les consoles et cartes son
Si vous projetez de faire uniquement de l’enregistrement en intérieur, sans forcément qu’il soit en direct, alors vous pouvez opter pour une carte son (idéal si on est seul·e), un Podtrack ou une console.
- Les carte son : la plus répandue est la Scarlett de Focusrite, avec une, ou deux entrées. Elle se branche en USB sur l’ordinateur, et vous permet de gérer vos prise de son sur celui-ci, tout en ayant une qualité de son optimale.
- Les podtracks : une jolie invention de Zoom, compromis entre un enregistreur et une console. C’est un petit objet à 4 entrées (sur lequel on peut brancher 4 micro externes), légers, qui fontionne sur piles.
- Les consoles : pour le podcast, la star reste la Rodecaster pro, qui, à près de 600€, sait faire beaucoup de choses et s’utilise très simplement. Nous, on l’a testée, et adoptée depuis longtemps pour sa simplicité et sa durabilité.
Les micros
Voilà bien un sujet délicat sur lequel chacun·e a son avis. Le nôtre n’engage que nous 😉 Ce qu’il faut savoir néanmoins, c’est que nous parlons ici essentiellement de micros pour la voix, pour la prise de son stéréo, et pour la prise de sons d’ambiances, qui sont trois prises de son différentes.
Un micro, mono ou stéréo, se branche sur un enregistreur mobile ou sur une console en studio. Nous parlons ici de micros n’ayant pas besoin d’une alimentation spécifique, car il est soit auto-alimenté
(avec une pile ou une batterie) ou alimenté par l’enregistreur, la carte son où la console sur laquelle il est branché.
⚠️ De façon générale, évitez les micro USB bas de gamme (et même haut de gamme…) qui sont généralement fragiles, peu qualitatifs et peu durables. Prenez la peine de mettre en place un set-up simple et adapté.
- Le tout terrain de la voix : l’indétrônable Shure SM58 est un micro qui a le défaut de sa qualité. Très cardioïde, il prend la voix au plus proche, et peut vous rendre de fiers services dans des contextes extérieurs bruyants. En studio, il fait aussi bien son travail, avec un rendu de voix assez chaud et rond. Son cousin, le SM58 bêta, est également un bon choix à un prix raisonnable.
- L’historique : le LEM DO21B, le “micro des journalistes” fait un son très beau et chaud, mais n’aura un rendu pro qu’avec un pré-ampli haut de gamme. Vous pouvez lui préférer un Sennheiser MD21, un peu cher (autour de 400€), mais dont l’efficacité n’est plus à prouver.
- En studio : le Shure SM58 convient bien pour les petits budgets. Au dessus, le modèle SM7B est aujourd’hui répandu et a fait ses preuves. Le constructeur Beyerdynamic fait également plusieurs modèles qui peuvent s’adapter à une console son de milieu de gamme.
- Les micro d’ambiance : c’est impossible de tout balayer, tout simplement ! disons seulement que pour ce faire, vous pouvez vous tourner vers des couples stéréo (deux micros qui reproduiront la stéréo de l’oreille humaine), ou bien des capsule type “micro canon”. Pour les stéréo, l’Apex 185 est une référence et reste très abordable. Mais notez qu’avec les capsules stéréo des enregistreurs cités plus haut, vous pouvez déjà faire beaucoup, beaucoup de choses !
- Les micro-cravate : nous n’en avons que peu testé, alors notre retour se limitera à ce que nous savons. Les Rode Wireless pro II rendent un son étonnament qualitatif au vu de leur taille, bien qu’un peu métallique. Cela peut avoir toute son utilité pour varier les prise de son en mouvement.
Le matériel d’écoute
Si on parle de casque audio, là encore, il existe beaucoup de marques et de modèles. En revanche, vous devez savoir que l’on ne fait JAMAIS de prise de son sans casque, même tout seul derrière son ordinateur. Pour les prises de son en intérieur (enregistrement solo ou studio), préférez les casques dits “de monitoring”, qui ont un rendu fidèle. Vos casques d’écoute ont souvent des amplificateurs de basse qui fausse votre écoute. Les casques de Beyerdynamic sont réputés, mais très chers. La marque Superlux en propose des moins chers, et tout à fait corrects en terme de durabilité, mais aussi de qualité et de confort.
Pour l’extérieur : si vous avez besoin d’un objet moins encombrant, vous pouvez mettre des oreillettes filaires, mais sans micro intégré, car cela risque également de vous poser des problèmes.
Le montage d’un podcast documentaire
Le montage de votre podcast documentaire peut constituer un vrai frein si vous n’avez pas ou peu d’expérience, et si votre projet ne bénéficie pas d’un accompagnement par un studio qui confiera cette tâche à un·e réalisateur·ice.
Ceci dit, il est possible que dans de nombreux cas de figures vous soyez amené·es à faire au moins un bout à bout, c’est à dire un prémontage avant une étape plus poussée de réalisation. Avant toute chose, assurez-vous de parler “la même langue” que la personne qui fera cette réalisation, et tenez un script de montage à jour.
Les logiciels de montage
Gratuit, payants, professionnels… il en existe beaucoup, et là encore, il est intéressant d’évaluer d’abord vos besoins avant de faire un achat de logiciel cher et dont vous n’aurez pas forcément la maîtrise.
- Audacity : l’interface est antique, il est peu fluide à prendre en main, et très limité. Vous pouvez commencer avec Audacity, qui est un logiciel gratuit, mais il vous faudra très vite passer à autre chose pour faire des montages propres, et du multipiste.
- Reaper : la star des utilisateur·ices amateur·es comme professionnel·les. Reaper n’est pas gratuit, mais s’utilise en version d’essai indéfiniment. Disponible sur tous les systèmes d’exploitation, régulièrement mis à jour, et avec une quantité incroyable de plugin, c’est le logiciel tout terrain qui vous permettra de passer un cap important en montage. Sa seule limite, ce sera le nombre de plugins trop importants une fois que vous en serez à des niveaux de sound design élevés.
- Audition : le logiciel de la suite Adobe, cher, très efficace, et doté d’une banque de son.
- Pro Tools : comme Audition, il est cher, très efficace, mais requiert un petit temps de prise en main. Sa version gratuite, Pro Tools First, est assez limitée.
- Et les autres… Hidenburg (plus adapté pour les radios, payant), Samplitude (cher… 400€ la licence !), Ardour (libre et gratuit, pas facile à mettre en place).
Comment financer mon projet ?
Pour commencer, il est important d’insister sur le fait qu’aujourd’hui la production podcast ne bénéficie d’aucune aide directe en France. Cet état de fait sera peut-être amené à changer, mais il est essentiel de comprendre que l’économie du podcast repose aujourd’hui sur un tissu d’auteur·ices qui font des projets podcast auto-produits, ou s’appuient sur une structure de production. Les structures de production de podcast en France n’ont, en 2025, aucune aide à la production, et auto-financent toutes les créations originales. La concurrence étant rude, il n’est pas facile de les convaincre de prendre votre projet… mais pas impossible non plus !
Les bourses d’auteur·ices podcast
Ce sont des bourses qui permettent aux auteur·ices d’écrire leur projet. Les montants sont souvent assez faibles, mais ils vous permettent de prendre ce temps d’écriture, et de convaincre une structure de vous produire.
- L’appel à projet du ministère de la Culture : aujourd’hui en suspens, il a distingué pendant trois ans des projets et leur allouait des enveloppes de quelques milliers d’euros. Il doit être reconduit, mais n’a pour le moment pas de date officielle de publication pour 2025.
- Les bourses de la SCAM : la société des auteurs radiophoniques propose tous les ans un concours avec plusieurs sélections pour des projets audio
- Les résidences d’écriture : elles permettent de passer du temps à l’écriture de son projet, parfois de façon libre, parfois avec une petite enveloppe à la clé
Plusieurs bourses existent mais sont tournées plutôt vers la radio.
La monétisation
Sans suspense, la monétisation repose essentiellement sur la publicité, sous toutes ses formes. Soit vous offrez un espace publicitaire à des annonceurs, soit vous faites la promotion des marques directement, ou bien vendez leurs solutions à vos auditeur·ices. Pour un projet documentaire, il faut être prudent de rester bien alignés sur les valeurs que votre projet défend, sous peine de perdre en crédibilité ce que vous gagnerez en financement.
- Affiliation : vous vendez (ou recommandez) des produits d’un autre site tout en touchant une commission. Il vous faudra nécessairement un site Internet
- Partenariat : c’est de la mise en avant de produits, sous forme de placement de produits notamment
- Conception de publi-podcasts : vous faites du podcast de marque pour des entreprises. Ce marché a eu ses heures de gloire, mais tend à baisser tendenciellement
- Abonnement : mise en place d’une offre premium (avec donc, des contenus de qualité) pour des abonnés
- Financement participatif : en one-shot, ou sur le long terme, ces personnes donnent pour soutenir votre projet
- La pub : il en existe de plusieurs sortes, et surtout, renseignez-vous auprès de régies publicitaires pour évaluer l’intérêt que cela représente pour votre projet
Le financement participatif
Focus sur ce mode de financement de projet, qui peut être vraiment pertinent pour financer un projet de documentaire en podcast. En particulier si vous disposez déjà d’une communauté. Car le financement participatif a pour vertu de faire connaître votre projet avant qu’il n’existe, et donc, de lui construire une base d’abonné·es qui ne peut que lui être utile une fois sa production terminée.
Faire une campagne de financement participatif requiert un travail certain en production de visuels, de slogans, etc. Mais cela crée également une adhésion forte à votre projet !
En conclusion : Votre projet documentaire peut mettre du temps à éclore, et pour l’écrire, il faut être patient·e. Prenez le temps de faire des repérages, de structurer votre projet, et d’évaluer vos besoins. Si vous voulez l’autoproduire, il vous faut une solide communauté pour vous suivre. Si vous voulez le faire produire, il vous faudra peut-être vous couler dans un format déjà existant, et tous ces choix influenceront forcément votre écriture. Et si vous vous sentez bloqué·es, faites-vous aider !